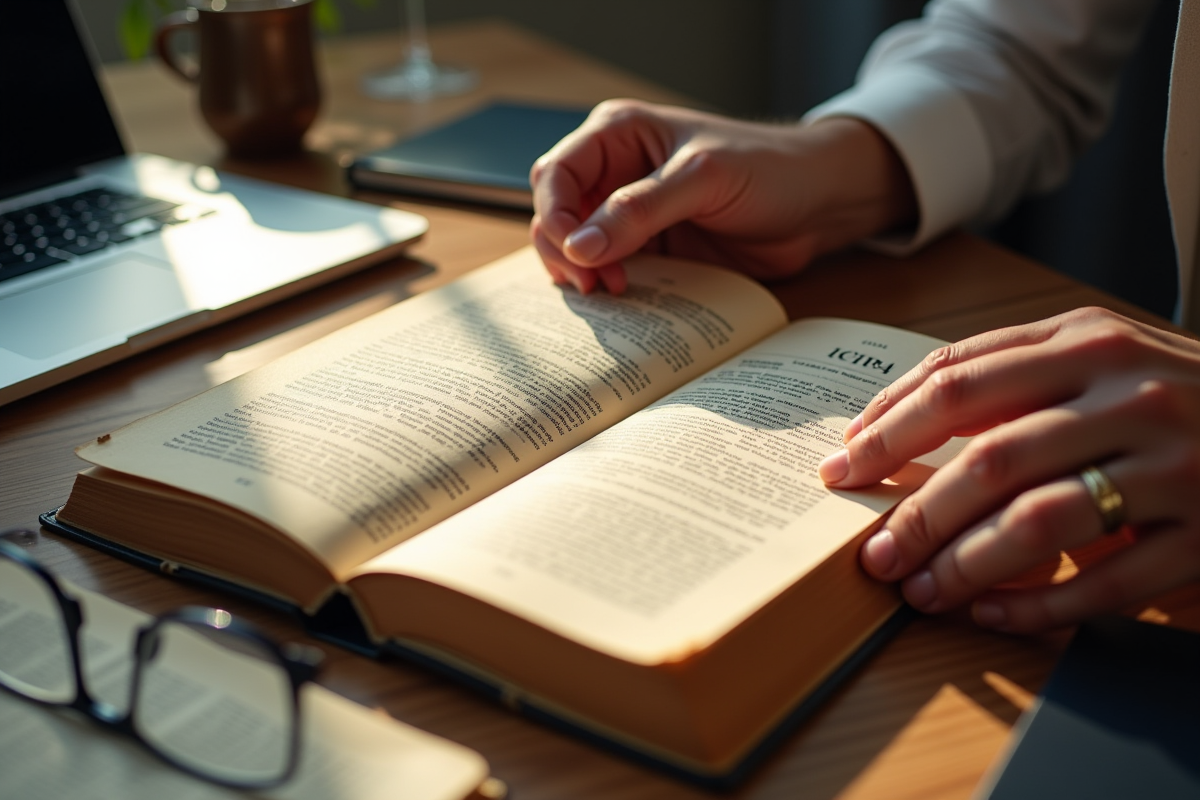Un texte gravé dans le marbre, quelques mots qui résonnent jusque dans les prétoires : l’article 1104 du Code civil n’est pas un vestige, c’est un levier. Derrière sa formulation sobre, il bouscule la pratique contractuelle française et impose, sans détour, un impératif de loyauté qui ne connaît pas de pause, ni de contournement.
L’obligation de bonne foi ne s’arrête jamais aux portes du contrat : elle s’impose dès la première prise de contact, s’invite dans les discussions, pèse dans la rédaction, puis surveille l’exécution. Depuis la réforme du droit des contrats de 2016, ce principe a pris de la hauteur : aucune convention particulière ne permet d’y couper. Les magistrats l’ont bien compris, et la jurisprudence récente le confirme avec fermeté. Même une mauvaise foi à la marge peut faire tomber un acte ou engager la responsabilité contractuelle.
Cette exigence va bien au-delà du simple fait de tenir sa promesse. Elle influence la manière de rédiger les clauses, oriente la conduite des parties et s’invite dans les solutions aux conflits. Le moindre comportement déloyal devient risqué, exposant à des sanctions parfois sévères.
La bonne foi, un pilier du droit des contrats français
La règle de bonne foi irrigue tout le droit des contrats. Dès la négociation, jusqu’à la rupture, elle s’impose aux parties et modèle les usages professionnels. Ce principe de loyauté n’est pas réservé au droit civil : il s’étend aussi bien au droit des sûretés qu’au droit du travail, engageant créancier, débiteur, caution, employeur ou salarié.
Face à la mauvaise foi, la bonne foi protège le consentement, la solidité du contrat, les garanties, les droits du créancier ou de la caution. Cette exigence, générale et mesurable objectivement, réclame loyauté, information, coopération. Les juges, appuyés sur la jurisprudence et la doctrine, n’hésitent pas à sanctionner toute tentative de dissimulation ou d’abus dans l’exercice des droits.
Voici comment cette exigence se manifeste concrètement :
- Dans la négociation, dissimuler une information clé fausse la donne et entraîne des sanctions.
- Lors de l’exécution, abuser d’un droit, détourner une protection ou refuser de collaborer devient une faute.
- Mettre fin à un contrat sans agir avec loyauté expose à l’obligation de réparer le préjudice causé.
Le solidarisme contractuel émerge : le contrat n’est plus un simple échange d’intérêts, mais un engagement réciproque fondé sur la confiance. Ce principe, qui structure le droit français, a désormais valeur de norme d’ordre public : ni la volonté des parties, ni la coutume, ne permettent d’y échapper.
Que prévoit exactement l’article 1104 du Code civil ?
L’article 1104 du Code civil pose une exigence de bonne foi à chaque étape du contrat : négociation, formation, exécution. Ce texte, né de la réforme du 10 février 2016, ne laisse place à aucune ambiguïté. Il affirme : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » La portée de cette règle va bien au-delà d’une simple invitation à la loyauté : la bonne foi s’impose du premier échange jusqu’à la fin des engagements.
Ce principe ne se réduit pas à un slogan. L’article 1104 se traduit dans plusieurs obligations concrètes : information, coopération, sécurité, proportionnalité. Aucune clause ne peut y déroger. La liberté contractuelle s’arrête là où commence l’exigence de loyauté. Le juge veille à ce que personne n’exploite abusivement un avantage contractuel, ne masque une information clé ou ne détourne une protection prévue par la loi.
La force obligatoire du contrat trouve ici ses limites. Impossible de réclamer l’exécution stricte d’un engagement si l’on agit de mauvaise foi. Plusieurs obligations s’en dégagent, dont voici les principales :
- Informer l’autre partie de toute donnée qui pourrait changer son consentement,
- S’interdire tout usage abusif des droits contractuels,
- Collaborer pour permettre une exécution honnête et équilibrée du contrat.
L’article 1104 s’impose donc comme une boussole du droit des contrats en France. La bonne foi y devient une norme impérative, qui dépasse les seules volontés individuelles.
Les réformes récentes ont-elles modifié l’exigence de loyauté contractuelle ?
La réforme du 10 février 2016 a marqué un tournant. L’article 1104, issu de cette refonte, fait de la bonne foi une véritable norme impérative, présente à chaque étape de la vie contractuelle. Certains ont parlé de rupture, d’autres y voient la continuité logique du solidarisme contractuel, déjà affirmé par la jurisprudence, notamment dans les arrêts Huard (1992), Manoukian, Baldus ou Macron. Mais le texte ne révolutionne pas le socle du droit français ; il consacre une exigence déjà bien ancrée dans la pratique judiciaire : la loyauté irrigue chaque étape du contrat, de la négociation à l’exécution.
La Cour de cassation avait déjà ouvert la voie, sanctionnant l’absence de loyauté, qu’il s’agisse de dissimulation ou de rupture brutale des discussions. La réforme grave ce contrôle dans le Code civil : désormais, le juge peut s’appuyer sur un texte clair pour intervenir face à des comportements déloyaux. La doctrine relève que la mention d’ordre public interdit toute renonciation préalable à la bonne foi.
| Arrêt | Principe dégagé |
|---|---|
| Huard | Renégociation contractuelle en cas de déséquilibre |
| Manoukian | Loyauté lors de la rupture des négociations |
| Baldus | Obligation d’information et limites de la dissimulation |
La bonne foi ne se limite donc pas à une formule. Elle façonne la pratique contractuelle : négociateurs, partenaires, créanciers, débiteurs sont tous concernés et doivent adopter une loyauté active. La réforme, en inscrivant cette exigence au cœur du droit des contrats, conforte le rôle du juge et clarifie la portée de l’obligation.
Impacts concrets de la bonne foi sur les relations contractuelles et la résolution des litiges
Le principe de bonne foi n’est pas qu’un idéal : il transforme la vie des contrats au quotidien. Dès la négociation, la loyauté s’impose. Toute réticence dolosive, toute dissimulation d’une information essentielle expose à la sanction du juge. Les parties, créancier, débiteur, caution, employeur, sont toutes soumises à un devoir actif de loyauté et de coopération. On ne peut pas se contenter de respecter la lettre du contrat : il s’agit d’agir avec équité, d’éviter tout usage dévoyé des droits conférés.
Au cœur des contentieux, la bonne foi se traduit par des conséquences très concrètes :
- Si un débiteur agit de façon déloyale, il peut se voir refuser l’exécution forcée du contrat,
- Un contractant de mauvaise foi peut perdre le bénéfice de la procédure de surendettement,
- Une caution ou un constituant qui ment sur sa situation patrimoniale perd certains droits à protection.
Dans les relations de travail, la bonne foi structure le lien entre employeur et salarié. L’employeur doit adapter les tâches, respecter la dignité, éviter les licenciements sans justification sérieuse. Le salarié, de son côté, doit se montrer loyal, discret, fidèle et s’abstenir de toute concurrence déloyale. Si un litige survient, le juge scrute les comportements : une clause utilisée abusivement, un détournement de protection, un droit exercé de façon déloyale, tout cela est passé au crible. L’article 1104 du Code civil agit alors comme un garde-fou, rappelant que la solidité du contrat repose sur le respect, l’équité et l’absence de ruse.
La jurisprudence ajuste la portée de chaque obligation en fonction de la situation. Elle veille à ce que la bonne foi ne soit pas un prétexte, mais bien le socle d’une justice contractuelle adaptée à la diversité des cas et à la réalité des rapports sociaux. Un principe vivant, qui oblige chacun à jouer franc jeu, sous peine de voir le contrat perdre toute sa force.